Le sédévacantisme est cette opinion théologique récente affirmant que le Siège de Pierre est vacant depuis le concile Vatican II, pour cause d’hérésie. L’ouvrage récent publié par M. Hecquard, La Crise de l’autorité dans l’Église, Les papes de Vatican II sont-ils légitimes ? (P.-G. de Roux, 2019) reprend cette thèse et en renouvelle l’argumentation. L’article “Les problèmes de méthode du sédévacantisme, autour d’un ouvrage récent” de l’éminent professeur Cyrille Dounot examine les sérieuses défaillances méthodologiques qui obèrent cette thèse (mésusage du droit canonique, extension de l’infaillibilité pontificale, généralisations indues).
Cyrille Dounot, docteur en droit, licencié en droit canonique, est agrégé des facultés de droit. Professeur d’histoire du droit à l’Université Clermont Auvergne, il s’intéresse au droit canonique. Dernières publications : La déposition du pape hérétique, Lieux théologiques, modèles canoniques, enjeux constitutionnels, Dir. C. Dounot, N. Warembourg, B. Bernabé, Paris, Mare & Martin, 2019 ; Les définitions. Les artifices du droit [II], Centre Michel de l’Hospital, Clermont-Ferrand, 2019 ; et « Du bien commun aux biens communs. Approches croisées », La Revue du Centre Michel de L’Hospital, no 19, 2019.
Les problèmes de méthode du sédévacantisme
Autour d’un ouvrage récent,
par Cyrille Dounot
NB : C’est nous qui surlignons dans le texte ci-après.
Le SÉDEVACANTISME est cette opinion religieuse dissidente, en périphérie de l’Église catholique, qui affirme (sous une forme ou une autre) que le siège de Pierre est vacant depuis quelques décennies, le pontificat de Jean XXIII étant le pivot, que ce pontife soit considéré comme le premier usurpateur du Saint-Siège, ou comme le dernier pape légitime.1 Comme tout courant doctrinal marginal, le sédévacantisme comporte une pluralité de chapelles et de dénominations (sédévacantisme, sédéprivationisme, catholicisme semper idem), qui n’enlèvent cependant pas ce qui fait l’unité du courant, à savoir le rejet des papes contemporains pour cause d’hérésie et l’affirmation de la vacance du Siège apostolique. Jusque-là très discret, ce courant bénéficie d’un regain d’actualité sans précédent avec la publication récente d’un ouvrage de Maxence Hecquard, La Crise de l’autorité dans l’Église.2 Le sous-titre de l’essai est des plus révélateurs, sous forme de question purement rhétorique : Les papes de Vatican II sont-ils légitimes ?
L’originalité de cette parution est double, et mérite que l’on s’y attarde. D’une part, il s’agit de la première parution d’un ouvrage sédévacantiste dans une maison d’édition largement diffusée. Il sort le sédévacantisme des ornières de la publication à compte d’auteur ou des samizdats imprimés à la va-vite et diffusés presque sous le manteau. D’autre part, cet ouvrage est le moins caricatural et le mieux écrit de cette littérature, et, à l’heure actuelle, le plus honnête et sûrement un des plus riches qui existent en langue française. Il faut dire que les ouvrages sédévacantistes ne brillaient pas par l’intelligence du propos, hormis les écrits des fondateurs de ce courant, savants théologiens tels Joaquín Sáenz y Arriaga ou Michel-Louis Guérard des Lauriers, o.p., et ceux de l’abbé Bernard Lucien. Aussi nous proposons-nous de critiquer l’essai de M. Hecquard principalement au regard de la méthode qu’il applique à son objet d’étude. L’A., philosophe de passion, s’est fait connaître du grand public en 2007 par un remarquable essai, salué et préfacé par Pierre Magnard, intitulé Les Fondements philosophiques de la démocratie moderne, qui en est à sa troisième édition. Or, il semble que la rigueur méthodique qui le conduisait à mener « un réquisitoire en bonne et due forme, parfaitement instruit et argumenté »3 sur la philosophie moderne, fasse défaut quand il s’agit de traiter des sciences religieuses. Sans porter un regard proprement théologique sur la justesse des opinions émises dans l’ouvrage, nous entendons porter un regard critique sur les défauts majeurs qui obèrent la thèse soutenue par l’A., défauts qui se retrouvent généralement dans ce genre de littérature, quoique plus grossièrement encore. La thèse est simple : les papes de Vatican II sont hérétiques, or les hérétiques sont privés de leurs offices ipso facto, donc ils ne sont pas papes. Elle est ainsi exprimée par l’A. : « Le pape étant infaillible et les propos conciliaires étant clairement hérétiques, si les “Papes de Vatican II” les énoncent, la seule explication est qu’ils ne peuvent être des pontifes légitimes » (p. 147). Dès lors, M. Hecquard fait usage de tous les arguments possibles pour appuyer sa thèse, usage bien souvent pris en défaut, tant par l’emploi partiel et partial de certains théologiens ou canonistes, que par une vision rabougrie de la théologie ou du droit canonique.
Pour simplifier la critique, nous réduirons à quatre les erreurs majeures de méthode présentées par l’ouvrage, qui se retrouvent plus largement dans le sédévacantisme dont il est un vulgarisateur intelligent. Ce sont quatre confusions qui consistent à prendre la partie pour le tout, le temporel pour l’éternel, le juridique pour du théologique, le faillible pour de l’infaillible. Il y aurait çà et là d’autres erreurs à relever, mais qui ressortissent plus à l’étourderie, et ne valent pas la peine que l’on s’y arrête.4
1. La partie pour le tout
Cette première erreur consiste à user largement de la synecdoque dans un sens non littéraire mais argumentatif, et à tirer profit d’un cas particulier pour le généraliser à l’ensemble du sujet évoqué. Quelques exemples illustrent bien ce défaut de méthode. Ainsi l’A. présente la « hiérarchie ecclésiastique », in toto, comme « ayant adhéré consciemment à des doctrines naguère condamnées par le magistère » (p. 28). De la même manière, l’A. cherche à assurer son propos sur la pensée des théologiens ou des canonistes, englobant tous les auteurs dans une même doctrine, tenue pour unanime, qui est évidemment celle qui sert son argumentation. Il affirme par exemple que « la sentence des théologiens et des canonistes est unanime : un pape qui, en tant que personne privée, aurait notoirement adhéré à une hérésie perdrait ipso facto son pontificat » (p. 41). Nous reviendrons sur la question, essentielle, de l’hérésie du pape, mais ce qui est pour le moins patent, c’est que les théologiens et les canonistes ne sont pas unanimes sur ce point-là … L’A. réitère ce genre d’argumentation par métonymie en référant pêle-mêle à « tous les théologiens » (p. 42) ou en invoquant « les théologiens » (p. 67). Le plus souvent, M. Hecquard renvoie à la pensée d’un ou deux auteurs (essentiellement Bellarmin ou Billot), et extrapole leur doctrine à l’ensemble des théologiens (catholiques, cela va sans dire). C’est encore le cas quand, au sujet de la perte du pontificat, il cite ces deux grands cardinaux puis le Jus canonicum de Wernz et Vidal, pour assurer au lecteur : « Donc, théologiens et canonistes se rejoignent » (p. 46). Plus loin il renvoie encore, quant au maintien de la juridiction du pape hérétique, à une idée qui serait « en fait l’exact contraire de ce que disent Paul IV, Bellarmin et les théologiens et canonistes depuis Vatican I » (p. 69). Même limitée à la période courant de 1870 à 1962, l’assertion est indubitablement contestable, et des ecclésiologues comme Journet admettaient une opinion contraire. Autre exemple de réductionnisme, celui de considérer que la « fonction principale et exclusive » des cardinaux n’est que l’élection du pape (p. 168), au détriment de leur mission de conseil, en tant que « sénat de l’Église », qui a pourtant précédé de plusieurs siècles leur droit d’élire le pontife.
D’autres hypothèses de confusion de la partie et du tout s’offrent à la lecture de l’ouvrage, sur d’autres plans, mais toujours dans l’optique de défendre mordicus la position sédévacantiste. Ainsi le voit-on gloser l’affirmation de Benoît XIV selon laquelle « le pontife romain est supérieur au droit canon » pour en tirer des conclusions qui ne sont pas contenues dans la prémisse, à savoir que « le pape n’est pas soumis au code » (p. 33). Il s’agit ici d’évincer certaines dispositions du Code de droit canonique de 1917 relatives à l’hérésie et aux monitions à adresser au clerc hérétique. C’est pourquoi il s’interroge, tout aussi faussement : « Pourquoi ce code contiendrait-il une disposition relative à quelqu’un qui ne lui est pas sujet ? » Ses affirmations sont erronées parce qu’en écrivant que l’Église n’est pas un « État de droit » il joue sur l’ambiguïté de l’expression, qui peut tout simplement signifier la réalité à l’œuvre dans l’Église, à savoir que le chef doit se conformer à l’ordre juridique établi, ce qui est bien le cas du souverain pontife dont l’action est, en plusieurs domaines, régulée par le droit canonique. Bien que délié (ab-solutus) des lois comme tout souverain, il peut néanmoins les modifier (dans les limites du droit divin positif et du droit naturel). Toutefois, tant qu’il n’a pas modifié la loi, il lui reste soumis. Innocent III, premier d’une longue série de papes, reprend une sentence d’Ausone, patere legem quam ipse fecisti, pour établir par la décrétale Quum omnes (X, 1, 2, 6) que « chacun doit utiliser pour soi le droit qu’il a établi pour les autres ».
La tendance de l’A. à généraliser des cas particuliers se signale également quand il cite des textes de souverains pontifes réputés hérétiques. Il surinterprète des extraits leur faisant dire ce qu’ils ne disent pas. L’exemple est ici tiré de l’exhortation apostolique Postrema sessio de Paul VI (4 novembre 1965), qui aurait « déclaré explicitement que Vatican II relève du magistère extraordinaire de l’Église » (p. 93). Il s’agit là d’affirmer que tous les textes adoptés par les Pères conciliaires, sans distinction, sont revêtus de la plus haute autorité doctrinale. Or, en note 2, l’A. a l’honnêteté (habituelle) de citer le texte sur lequel il fonde son opinion, texte qui distingue très clairement les « points de doctrine qui ont été exposés par le magistère extraordinaire de l’Église » des « sages mesures disciplinaires » adoptées par Vatican II. Nous reviendrons sur ce point, car l’A. confond systématiquement le plan disciplinaire et le plan doctrinal, rangeant la totalité des actes conciliaires dans la catégorie de la doctrine. Cela est tout à fait abusif, et reviendrait à canoniser des dispositions passagères, relevant de la simple organisation de la société (civile ou ecclésiastique du reste). Les règles disciplinaires fixées par les anciens conciles, pour saintes qu’elles soient, ne constituent pas pour autant des règles de foi fixées ne varietur. Un exemple tiré du premier concile œcuménique permettra d’assurer cette opinion. En effet, les prescriptions du concile de Nicée de 325 (can. 20), prescrivant de prier debout contre ceux qui « fléchissent le genou le dimanche et pendant les jours de la Pentecôte », énergiquement rappelées par le concile de Chalcédoine de 451 (can. 1), n’ont pas empêché l’Église de revenir sur cette antique discipline.
De même, quand il fait dire à la lettre Cum iam de Paul VI (21 septembre 1966) que « Vatican II est la règle prochaine et universelle de vérité en matière de foi et de mœurs » (p. 95), il trahit le texte qu’il donne pourtant en note. Le pape affirmait que la « doctrine transmise par le Concile […] approuvée par l’autorité d’un Synode œcuménique […] appartient déjà au magistère de l’Église », et qu’il convient « de se garder de la dissocier d’avec le reste du patrimoine sacré de la doctrine de l’Église ». Paul VI renvoyait d’ailleurs à une herméneutique de la continuité en rejetant l’idée qu’il puisse « y avoir quelque différence ou opposition entre eux ». Là encore, l’idée est de faire dire au pape que seul le concile Vatican II est la règle de la foi, quand le pape affirme que ce rôle est dévolu à la doctrine de l’Église, comprenant tout à la fois « le magistère ecclésiastique d’autrefois » et celui de Vatican II, « dont il représente la suite, l’explication et le développement ». Le théologien peut interroger cette présentation des faits, il n’en demeure pas moins qu’elle est donnée avec autorité et doit servir de guide de lecture des actes de Vatican II.
Enfin, dans sa tentative de justifier la position sédévacantiste au regard de la visibilité de l’Église, ce que l’A. dénigre comme un maintien « à tout prix de la légitimité de la hiérarchie ecclésiastique en place pour sauver la visibilité de l’Église » (p. 154), il écrit sans sourciller que « même réduite à quelques prêtres et quelques familles l’Église reste visible » (p. 155) ! Sans entrer dans la casuistique des notes de l’Église, spécialement celle de l’apostolicité, il est assez incongru de voir admettre que l’Église saurait subsister sans la succession apostolique dans un petit groupe de familles et de prêtres.5
2. Le temporel pour l’éternel
Deuxième écueil du sédévacantisme hecquardien, celui d’une vision anhistorique de l’Église, de ses institutions et de son droit. S’il affirme, avec l’autorité de saint Augustin et de saint Thomas, que la nouveauté doctrinale est un marqueur de l’hérésie (p. 25, n. 1 et 53), il ne pense pas une seconde à l’appliquer au sédévacantisme, idée neuve dont on ne trouve pas de trace avant le pontificat de Paul VI. En fait, l’A. semble considérer l’Église comme figée à un moment donné de l’histoire, qu’il situe (au gré de ses démonstrations) entre le concile de Trente et le second concile du Vatican. De ce point de vue, il faut souligner l’usage exclusif qu’il fait du Code de droit canonique de 1917, renvoyant simplement dans son ouvrage au Code de droit canonique (p. 25), comme s’il n’y en avait qu’un. Le lecteur non averti pensera, à tort, que l’A. parle du droit positif de l’Église, puisqu’il ne considère pas même l’existence du Code de droit canonique de 1983, sans justifier pour le moins sa position. De ce fait, il renvoie aux dispositions surannées du code pio-bénédictin [Code de droit canonique de 1917, ainsi nommé parce que promulgué le 19 mai 1918, jour de fête de deus papes : Pio et Benoît]… uniquement quand cela l’arrange. Car dans certaines hypothèses, l’A. revient au droit canonique antérieur à la première codification. Ainsi quand il s’agit de justifier l’emploi de la bulle Cum ex apostolatus de Paul IV, qui écarte notamment les cardinaux hérétiques de l’élection pontificale, tant active que passive, et frappe de nullité l’élection du pontife hérétique. Il fait de cette bulle un texte infaillible, « valide perpétuellement » (p. 29), non abrogé et dont les dispositions sont « valables à perpétuité » (p. 31), « toujours en vigueur » (p. 34, 35, 156) et ce malgré les dispositions explicites de saint Pie X, dans la constitution Vacante Sede Apostolica du 25 décembre 1904. Ce dernier rend aux cardinaux leur voix active et passive dans l’élection du souverain pontife, interdisant qu’aucun d’entre eux en soit privé « sous le prétexte et à cause de n’importe quelle excommunication, interdit ou empêchement, ou autre cause relevant de l’Église » (§ 29).6 Cette suspension provisoire de toute censure, durant le temps de l’élection, remonte en fait bien plus haut. Clément V, par la constitution Ne Romani (Clem. 1, 3, 2) fut le premier à l’édicter, et elle fut reprise par Pie IV et Grégoire XV. Intégrée explicitement dans le Code de droit canonique de 1917 (can. 241), elle sera confirmée par Pie XII en 1946 (constitution Vacantis Apostolicae Sedis, § 34). L’actuelle législation canonique (constitution Universi dominici gregis, § 35, de Jean-Paul II de 1996, modifiée par le motu proprio Normas nonnullas de Benoît XVI de 2013) conserve cette suspension de toute censure ecclésiastique frappant un cardinal pendant la durée du conclave. Nonobstant tous ces textes, M. Hecquard juge de façon laconique la proposition selon laquelle « l’éventuelle hérésie d’un cardinal ne saurait l’empêcher d’être élevé à la dignité pontificale » : « Cette objection n’est pas sérieuse » (p. 169).
Enfin, il est à noter que Pie X, dans la préface de sa constitution, loue les « lois très sages » de ses prédécesseurs apportant « un soin vigilant et une réflexion pleine de zèle » au sujet de l’élection pontificale, sans mentionner aucunement le texte ni le nom de Paul IV. La constitution de Pie XII renvoie aux textes de Clément V, Pie IV, Grégoire XV, Clément XII, Pie X et de quelques autres, mais ne réfère pas à la bulle Cum ex apostolatus, qui ne fut qu’un hapax canonique. De toutes façons, elle fut abrogée par le can. 6,6o du Code de droit canonique de 1917 au titre des « lois disciplinaires […] qui ne sont reprises dans le Code ni explicitement ni implicitement » et qui perdent de ce fait toute valeur. Tout ceci est fâcheux pour la discipline instaurée par la bulle Cum ex apostolatus, véritable pierre d’angle du sédévacantisme. La thèse centrale de l’A. est portée par ce texte, telle que résumée dans ce sophisme : « Si Vatican II est hérétique [ce qu’il postule], tous les “papes” y ayant adhéré avant leur élection sont par hypothèse hérétiques. Leur élection est donc nulle en soi » (p. 148).7 Ce syllogisme implique la nullité de l’élection pour cause d’hérésie, nullité qui n’est plus une disposition du droit positif, au moins depuis 1904. Aussi l’A. cherche par tous moyens à réintroduire ce texte dans la légalité pio-bénédictine. D’une part, il y voit un texte infaillible, de droit divin, ce qui constitue l’erreur méthodologique de prendre le faillible pour l’infaillible sur laquelle nous reviendrons plus loin. D’autre part, il argue d’une reprise partielle de certaines dispositions dans six canons du Code de 1917 (p. 32). Cela est contre-productif, car si le législateur a connu ce texte, en a repris certains aspects et l’a volontairement intégré aux sources (publiées par la suite), c’est qu’il entendait explicitement ne retenir que ces dispositions, et non les autres.8 L’élément central de la démonstration, le can. 188, 4 o ayant trait à la renonciation tacite de tout clerc apostat, rendant vacant son office « ipso facto sans aucune déclaration », est quant à lui révélateur d’une nouvelle erreur de méthode, confondant le juridique et le théologique.
3. Le juridique et le théologique
Cette erreur tend à confondre les plans entre ce qui relève du droit et ce qui relève de la théologie. Elle est la plus excusable chez un non-juriste, mais elle est néanmoins lourde de conséquences, comme nous le verrons au sujet de la dernière erreur de méthode de M. Hecquard. Ce travers tient notamment à la faiblesse de sa documentation sur le sujet. Ainsi, quand il s’intéresse aux canonistes, l’A. renvoie aux « plus fameux canonistes » (p. 46), mais ne cite que l’ouvrage de Wernz et Vidal, certes estimable, mais qui n’est pas le tout de la canonistique (fût-elle romaine). De surcroît, ces canonistes réputés, s’ils adoptent la position de Bellarmin sur la déchéance ipso facto du pape hérétique, ne mésestiment pas pour autant les autres. Dans son Ius Decretalium (publié après Vatican I), Wernz résume les cinq hypothèses possibles au sujet du pontife hérétique, et redit que la première d’entre elles, qui nie la possibilité d’un pape hérétique, est certes « pieuse et probable, mais ne peut être dite certaine ni commune. »9 Il renvoie, en sens contraire, au sermon d’Innocent III estimant possible qu’un pape tombât dans l’hérésie, tout en rejetant comme apocryphes les canons présents chez Gratien, ce qui est certes vrai absolument, mais qui ne correspond pas à la croyance médiévale ni à l’édifice théologique bâti sur le fondement de ces canons, principalement le canon Si papa (D. 40, c. 6). 10
L’A., prévenu contre l’argumentation canonique, met en garde son lecteur contre « l’erreur grossière du juridisme » (p. 27), au risque de tomber dans le travers opposé. Ici, l’illusion de l’A. est de considérer qu’une loi ecclésiastique touchant à l’organisation de l’Église (en l’occurrence celle de Paul IV) est en fait une loi portant sur la nature même de l’Église, c’est-à-dire une loi de nature théologique révélant une disposition immuable : « Il s’agit bien là de droit divin » (p. 165).11 Ce texte ne fut écrit « que pour éclairer la constitution de l’Église » (p. 34), et relève de ces lois « de droit divin positif ou naturel » qui n’ont pas été abrogées par la réforme de 1917. Il en irait de même du can. 188, qui « reflète la disposition de droit divin » (p. 157). D’une part, c’est se méprendre tout à fait sur ce qu’est le droit divin positif (issu directement de la Révélation) ou naturel. D’autre part, c’est une pure pétition de principe, qui n’est autrement argumentée que par la force de l’interrogation suivante : « La nature même de l’Église n’est-elle pas de droit divin? », qui n’est niée par personne. Il resterait à démontrer qu’une loi disciplinaire, c’est-à-dire portant sur la discipline ecclésiastique entendue comme l’organisation interne de la structure ecclésiale, est en fait une loi organique, portant sur la nature même de cette Église, ce que l’A. ne fait pas, et pour cause. Pour lui, « la nullité de l’élection d’un hérétique à la papauté » est la « conséquence de la nature même de l’Église qui est la société des croyants » (p. 33). Là encore, la déduction est fausse. Si l’Église est effectivement la société des croyants, il ne s’ensuit pas que la nullité (juridique) d’une élection (elle aussi juridique) soit la conséquence de la nature théologique de l’Église d’être une société de croyants. L’Église a pu prononcer la nullité d’une telle élection (Cum ex apostolatus), tout comme elle a pu, et peut encore aujourd’hui, prononcer la validité de cette élection. C’est un point tout à fait contingent, proprement juridique, et non lié à la nature même de l’Église.
En outre, l’A. fait un usage tout à fait impropre du can. 188, 4o du Code de 1917. D’abord, parce que ce texte vise uniquement le cas du clerc qui a fide catholica publice defecerit. L’expression vise l’apostasie et non l’hérésie. Ce point essentiel, pourtant caché ou ignoré de M. Hecquard, suffirait presque à disqualifier sa thèse tant ce canon est brandi comme argument massue de la perte du pontificat pour cause d’hérésie (p. 32, 65, 70-71, 158-159, etc.). Les manuels ou traités de droit canonique traduisent cette « défection publique de la foi catholique » par l’apostasie, crime bien plus grave que l’hérésie.12
Ensuite, il extrapole les conditions de la renonciation tacite, prévue par le can. 2314 (CIC 17), au cas d’hérésie. Là encore, l’A. se fourvoie au sujet de la perte de juridiction ipso facto. Voulant à tout prix que l’hérésie fasse automatiquement perdre à tout clerc sa juridiction (p. 71), il force la lecture du can. 188, 4o combiné au can. 2314. Or, le can. 2314, § 1, 2o prévoit bien que l’hérétique, le schismatique ou l’apostat (ici les trois catégories sont concernées, contrairement au can. 188, 4o) doit recevoir une monition avant d’être privé de son office. Le can. 2222, § 1, ignoré de l’A., règle la mesure du pouvoir coercitif de l’Église, statuant que « le coupable ne peut être puni avant d’avoir reçu une monition avec menace d’une peine latae ou ferendae sententiae ».13 La nécessité d’un acte déclaratoire, en cas d’apostasie, a d’ailleurs intégré plus nettement le Code de 1983, dont le can. 194, § 1, 2o abandonne la clausule sine ulla declaratione présente dans l’ancien can. 188.
Il va sans dire, comme le rappelle l’A., que « la peine ne formalise pas la faute » (p. 27), mais au point de vue juridique qui intéresse la question (à savoir le maintien dans un office), il est essentiel que la faute soit formalisée par une procédure adéquate (la monition puis le jugement), permettant l’application de la peine (la perte de l’office). Le principe de sécurité juridique veut que les peines soient normalement ferendae sententiae, c’est-à-dire infligées par une autorité judiciaire, à moins qu’elles n’intègrent expressément le champ dérogatoire des peines latae sententiae, encourues par le fait même de la commission du délit (can. 2217, § 2 [CIC17], can. 1314 [CIC83]). Wernz, traitant des délits qui entraînent la perte de l’office avant le Code, distingue entre ceux qui agissent ipso facto (dont l’hérésie), et ceux qui agissent par sentence condamnatoire, mais ajoute aussitôt que même les délits qui entraînent automatiquement la déchéance « requièrent une sentence déclaratoire, rendue par le for ecclésiastique ».14
Enfin, l’A. évacue toute la procédure contentieuse prévoyant que la privation d’un office ecclésiastique requiert un collège de trois juges (can. 1576, § 1, 1o [CIC17]; can. 1425, § 1, 2o [CIC83]), et que la déposition du clerc oblige à une nouvelle monition, après la privation (can. 2303), avec constitution d’un tribunal de cinq juges (can. 1576, § 1, 2o [CIC17]). Il a ainsi tort d’affirmer que, « en cas d’hérésie, l’office est perdu dès que le défaut est public » (p. 158), et son argumentation à partir d’un seul exemple tiré du Ve siècle (celui de saint Hypathius) n’a rien de probant. De même, exciper de ce que Paul IV « ne fait pas état » (en 1559) de la « procédure de monitions » codifiée en 1917 pour les rejeter est une baraterie (p. 160). La procédure est longue, codifiée, rationnelle, et ne s’autorise pas d’une déchéance ipso facto, même pour cause d’hérésie publique. Si tant de précautions procédurales sont prises pour un simple prêtre, on voit mal comment il suffirait d’un simple constat effectué par un particulier pour déclarer la déchéance du pape.
Un autre argument bancal est avancé par l’A., trouvant au can. 188, 4o un « parallèle pour les religieux » renvoyés de leur ordre, avec le can. 646, § 1, 1o (p. 159). Il s’agit là encore du religieux apostat, et non de l’hérétique, rendant vaines les considérations sur l’absence de nécessité (autre que pratique) d’une déclaration constatant le fait (p. 160). Quand l’A. écrit qu’« il est faux de prétendre que les actes d’un hérétique seraient valides jusqu’à la sentence le condamnant », il s’insurge sans le savoir contre sept siècles de pratique canonique. Les solutions données par Boniface VIII sur la légitime possession des biens des hérétiques jusqu’à la sentence déclarant leur hérésie ont servi depuis lors à définir le régime juridique des droits et obligations de l’hérétique, donnant un rôle central à la décision de justice (Cum secundum leges, VI, 5, 2, 19).
Autre confusion entre le droit et la théologie, son usage inexact de la notion canonique de suspicion d’hérésie (supprimée dans le Code de 1983). Pour l’A., la suspicion d’hérésie est le « doute légitime sur l’hérésie d’un clerc » (p. 72), à savoir un soupçon sur l’orthodoxie de la personne. Or, la notion de suspicion d’hérésie, visée par le Code de 1917 (can. 2315 s.), concerne les agissements, non les doctrines. C’est « une présomption de droit contre celui qui, par sa façon [de faire], semble professer l’hérésie ».15 Cette présomption permet d’appliquer des peines, graduellement, en fonction de la pertinacité du coupable qui, « après monition, n’écarte pas la cause de la suspicion » (can. 2315 [CIC17]), jusqu’à le tenir pour hérétique et sujet aux peines applicables aux hérétiques. Il est donc inapproprié d’en faire l’institution (juridique) garante de « l’éventuelle hérésie de l’inculpé » (p. 73), rôle dévolu au can. 2314 (CIC17). De plus, le can. 2317 (CIC17) impose, en matière d’enseignement de doctrines réprouvées (mais non hérétiques), une sentence de condamnation.
Cette mécompréhension de la suspicion d’hérésie s’étend par ricochet au concept même d’hérésie. La théologie de l’A. semble ici bien légère quand il s’agit de « prouver » l’hérésie de Vatican II, établie par sa manière d’être (praxis) avant même de l’être par ses doctrines (theoria) : « À première vue le choix des moyens prônés par Vatican II, c’est-à-dire sa démarche même, apparaît bien nouveau et erroné, donc hérétique » (p. 53). Sa conception même de l’hérésie est boiteuse, étendue aux actes et non seulement aux croyances : « Une hérésie peut donc se traduire par de simples actes », car « elle ne requiert pas une adhésion formelle à un corpus doctrinal » (p. 132). C’est évidemment outrepasser la notion même d’hérésie, négation obstinée d’une vérité de fide divina, telle que définie en doctrine (cf. Sum. theol., IIa-IIae, q. 11, a. 2 : « L’hérésie a pour domaine les vérités de foi comme sa matière propre »), comme dans le droit canonique (can. 1325, § 2 [CIC17]; can. 751 [CIC83]).
Qu’il suffise de rappeler que Mgr Lefebvre a signé tous les documents conciliaires, de même que Mgr de Castro Mayer, pour s’étonner de la facilité avec laquelle notre A. accuse d’hérésie tous les prélats de la chrétienté.16 Ce défaut se retrouve bien souvent dans son œuvre, faisant feu de tout bois pour tenter de convaincre de sa démarche. Ainsi le voit-on prouver l’hérésie du second concile du Vatican de manière anachronique par des faits ou des doctrines imputables à Jean-Paul II, au cardinal Ratzinger ou au pape François (p. 54-55).
4. Le faillible et l’infaillible
Dernier point saillant, celui d’une extension sans pareille de l’infaillibilité. Tout au long de l’ouvrage, M. Hecquard soutient une thèse pour le moins surprenante faisant du souverain pontife une pythie toujours véridique, jamais en faute, quelles que soient les circonstances de son intervention, « les papes étant infaillibles dans le cadre de leurs fonctions » (p. 42). Le pluriel n’est pas ici une coquille d’imprimeur, tant le propos est maintes fois repris. Abolissant la notion de pape docteur privé ou particulier, il fait du pape un docteur perpétuel : « Même destinés à des particuliers, les enseignements pontificaux ont une valeur universelle » (p. 60).17 Il assène que « les papes de Vatican II ne parlent pas comme des docteurs privés » (p. 69), et s’interroge faussement : « L’histoire montre-t-elle des exemples d’un tel enseignement ? » (p. 61), sous-entendu enseignement particulier. Sans faire la liste de tous les papes qui, tels Pie II ou Benoît XIV, ont publié des ouvrages particuliers parvenus au suprême pontificat, mentionnons simplement les exemples plus récents de Jean-Paul II (Mémoire et identité) ou de Benoît XVI (Jésus de Nazareth).
M. Hecquard estime que lorsque « le pape s’adresse au public, c’est forcément en tant que pape » (p. 60), quelle que soit la nature du discours tenu (conférence de presse ou déclaration solennelle sont mises sur un pied d’égalité). Cela est simple : « Le magistère du Souverain Pontife est unique, quel que soit son mode d’expression » (p. 111), ce qui là encore détruit toute hiérarchisation formelle des genres discursifs ou didactiques de la papauté, pourtant adoptée par la publication officielle des Acta Apostolicae Sedis. Pour notre A., « un document pontifical officiel [en existe-t-il des officieux ?] portant sur la foi ou les mœurs non infaillibles ne peut exister » (p. 73), et ce document, « par conséquent […] est couvert du charisme de l’infaillibilité », étant « inévitablement infaillible » (p. 74). Ailleurs, il juge que « l’infaillibilité est ou n’est pas, elle ne peut coexister avec la faillibilité » (p. 100).
Si les choses sont si claires, il est curieux d’observer à quel point les débats sur l’infaillibilité pontificale en 1870 ont été vifs, et le fait que la papauté ait explicitement fixé des conditions à l’exercice de l’infaillibilité par la constitution Pastor aeternus. Ce texte insiste sur deux conditions cumulatives, à savoir de parler ex cathedra, « remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens », et de définir « qu’une doctrine, en matière de foi ou de morale, doit être admise par toute l’Église ». L’importance de cet aspect définitionnel ne saurait être réduite à néant, pas plus que l’aspect magistériel proprement dit. Pour éviter les confusions, les pères du concile Vatican I ont d’ailleurs adopté un amendement introduisant une précision dans le titre du schéma, initialement intitulé De Romani Pontificis infaillibilitate et renommé De Romani Pontificis infaillibili magisterio, resserrant l’infaillibilité au domaine de l’enseignement, et non du gouvernement ou de la législation.18 M. Hecquard tord la pensée de dom Nau, en prétendant que les encycliques sont de soi infaillibles puisqu’« il suffit que le pape enseigne en matière de foi ou de mœurs » (p. 105). Le bénédictin dit l’inverse,19 en restreignant l’infaillibilité dans les encycliques aux seuls « jugements dogmatiques s’imposant à l’assentiment des fidèles » répondant aux conditions fixées en 1870 : « L’objet de la définition doit être une matière de foi ou de morale, le Souverain Pontife doit y exercer son rôle de Docteur et de Pasteur universel, enfin l’acte lui-même doit être un jugement sans appel. »20
Pour arriver à cette impressionnante conclusion d’un pape sempiternellement infaillible, qui rappelle plus les vaticinations des oracles antiques que les vaticanesques prises de paroles, l’A. malmène l’ecclésiologie de saint Robert Bellarmin. Il réduit sa pensée à deux points, tout en prévenant que sa doctrine « est aussi simple que radicale » (p. 39) : le pape qui serait hérétique perdrait sa charge ipso facto ; « en fait le pape ne peut pas se tromper, car il entraînerait l’Église dans son erreur et les hommes ne seraient pas sauvés » (p. 40). Cette seconde affirmation est déjà, par sa généralité, abusive. Elle est en outre infidèle à Bellarmin, qui la jugeait seulement pieuse et probable (comme l’A. le concède, p. 39). Elle est enfin contradictoire avec la première proposition (si le pape ne peut se tromper il ne peut, a fortiori, pas tomber dans l’hérésie), et c’est bien pourquoi Bellarmin la présentait comme une option théologique, non comme une vérité à croire de fide.
M. Hecquard se range explicitement à l’opinion du P. Marín-Sola contre la foi ecclésiastique, cet enseignement magistériel portant sur des faits ou des vérités connexes à la vérité révélée (p. 138-139). Là encore, il érige en dogme ce qui ne relève que de l’opinion, qui plus est minoritaire.21 La raison est simple : il s’agit de lutter contre ceux qui estiment que la déclaration Dignitatis humanae ne relève pas de la foi divine, mais au mieux de la foi ecclésiastique, « dont la censure n’est pas l’hérésie » (p. 132). L’A. ne prend pas la peine de s’intéresser aux développements pontificaux (homogènes pourtant) sur l’autorité du « Magistère en matière de soi non irréformable ».22 Le motu proprio Ad tuendam fidem, de 1998, est venu préciser encore « le devoir d’adhérer aux vérités proposées de façon définitive par le Magistère de l’Église », soulignant a contrario l’existence d’un magistère non définitif. L’attitude de « soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence » (Lumen gentium, § 25), requise par un tel enseignement, a été par ailleurs précisée et distinguée du niveau encore inférieur d’un magistère pédagogique, non normatif.23
Sa lecture des actes du second concile du Vatican trahit encore un défaut de rigueur critique. D’emblée, il considère que toutes les constitutions, dans toutes leurs parties, sont infaillibles car « dogmatiques » (p. 91), oubliant que seules deux constitutions portent cette épithète (Lumen gentium et Dei Verbum), Gaudium et spes portant celle de « pastorale » et Sacrosanctum concilium étant dépourvue de toute qualification. Cette méprise sur l’intitulé d’une catégorie juridique est en soi révélatrice. De plus, l’A. confond le pastoral et le moral pour attribuer la note d’infaillibilité à tous les documents, et non plus seulement aux constitutions, et ce, alors qu’il cite in extenso la note liminaire à Gaudium et spes mettant en lumière le caractère contingent et mouvant de certains éléments, même dans une constitution. Quand le concile se dit pastoral, M. Hecquard entend « jugement pratique », donc moral, donc couvert : « Aucune règle posée par un pape, même si elle porte sur le seul comportement ou la manière d’agir des fidèles, n’échappe au charisme de l’infaillibilité » (p. 92).24 Il fait de la formule d’adoption des documents un critère d’infaillibilité (p. 94), sans se rendre compte qu’elle est stéréotypée, unique pour tous les documents, même les déclarations, et partant, constitutive d’une clause de style.25 Quand il s’agit de questionner la liberté religieuse, l’A. confond volontairement le droit de pratiquer un faux culte et l’absence de contrainte en matière religieuse (p. 143).26
Son usage des autorités doctrinales est tout aussi orienté, et il n’hésite pas à embrigader des théologiens orthodoxes dans son camp : « Si saint Robert Bellarmin avait vécu à notre époque, il eût jugé que le “pape” qui les a ratifiés [les décrets de Vatican II] ou perd sa charge ipso facto, ou, pour une raison ou une autre, n’était pas pape quand il les a ratifiés » (p. 100). Il fait sienne la doctrine de Billot tant que cela l’arrange. Quand l’illustre théologien écrit que Dieu « ne peut permettre que l’Église entière admette un pontife qui ne soit pas vrai et légitime » (p. 45), ce qui vient à réduire à néant la thèse sédévacantiste, l’A. ajoute : « Que dirait ce bon cardinal aujourd’hui? » Toujours au sujet de l’universalité de l’Église, l’A. fait de la théologie-fiction pour asséner que Billot « n’eût certainement pas admis qu’on s’appuyât sur sa doctrine pour défendre les papes conciliaires » (p. 172), alors que ce dernier écrit expressément Ecclesiae adhaesio omne vitium electionis radicitus sanat, voyant dans l’adhésion de l’Église à la personne du pape une sanatio in radice constituant « une marque infaillible de sa légitimité » (p. 171). L’A. excelle à évincer le théologien (« l’amour de la sainte Église n’aveugle-t-il pas l’illustre théologien? », p. 175), mais peine à trouver la réponse adéquate : « L’adhésion de l’Église à ces pontifes modernistes ne les a pas guéris de leurs erreurs […]. Elle a eu au contraire pour effet que l’Église a sombré dans le modernisme » (ibid.). Quand il s’agit de prendre parti contre la distinction entre foi ecclésiastique et foi divine et catholique, il opte pour les dominicains Marín-Sola et Guérard des Lauriers, « malgré l’autorité du cardinal Billot » (p. 137).
De même, selon M. Hecquard, il n’y a pas lieu de considérer l’opinion du cardinal Journet (pourtant de l’avis de Jean de Saint-Thomas au sujet de la déposition du pape hérétique), car il fait « un pas vers la collégialité de Vatican II et de la démocratisation de l’Église. Maritain n’est pas loin » (p. 163). Il est vrai qu’il est rangé au rang des « hérésiarques du xxe siècle » (p. 165), ce qui suffit à l’écarter.
La conclusion de l’A. est aussi simple que simpliste : il a raison, seul contre tous. « Les diverses théories avancées pour défendre [la] légitimité [des “occupants du Siège de Pierre depuis Vatican II”] ne sont pas conformes à la saine théologie. Elles sont fausses. Parce qu’ils contredisent le dogme catholique, les pontifes conciliaires n’ont donc aucune autorité dans l’Église. Telle est la conclusion légitime de ceux que l’on nomme “sédévacantistes” » (p. 249). Au regard des quelques éléments appréciés ici, il n’est pas sûr qu’on puisse appeler légitime une telle démarche aux accents d’amateurisme.
Cyrille Dounot
- Sur ces aspects, voir Paul Airiau, « Le pape comme scandale. Du sédévacantisme et d’autres antipapismes dans le catholicisme post-Vatican II », dans Les Laïcs prennent la parole, La participation des laïcs aux débats ecclésiaux après le concile Vatican II, Actes du colloque à l’Institut catholique de Toulouse (30 janvier-1er février 2014), Sous la dir. de J.-Fr. Galinier-Pallerola, Ph. Foro, A. Laffay, Paris, Parole et Silence, 2014, p. 427-445 ; Frédéric Luz, Le Soufre et l’encens, Enquête sur les Églises parallèles et les évêques dissidents, « Place royale », Paris, Claire Vigne, 1995, p. 151-209. [↩]
- Maxence Hecquard, La Crise de l’autorité dans l’Église, Les papes de Vatican II sont-ils légitimes ?, Paris, Pierre-Guillaume de Roux, 2019, 1 vol. de 320 p. [↩]
- Pierre Magnard, « Préface », dans Maxence Hecquard, Les Fondements philosophiques de la démocratie moderne, Paris, Pierre-Guillaume de Roux, 32016, p. 15 [↩]
- A titre d’exemple, il parle sans cesse du De Romano Pontifice de Bellarmin, quand il s’agit du De Summo Pontifice ou du De Romani Pontificis ecclesiastica hierarchia, et il fait dire à ce texte ce qu’il ne dit pas, notamment p. 59, n. 1 [↩]
- Contre l’utilisation abusive d’une citation du cardinal Pie (« L’Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques », Discours à Nantes, 8 novembre 1859), rappelons simplement cet extrait Grand Catéchisme de saint Pie X (Partie I, chap. 10, § 2) : « Et le corps de l’Église, en quoi consiste-t-il ? Le corps de l’Église consiste en ce qu’elle a de visible et d’extérieur, comme l’association de ses fidèles, son culte, son ministère d’enseignement, son organisation extérieure et son gouvernement » (nous soulignons). [↩]
- Documents pontificaux de Sa Sainteté saint Pie X, t. 1. 1903-1908, s.l., Publications du « Courrier de Rome », 1993, p. 229. Il s’agit du § 34 pour l’édition latine disponible sur le site du Vatican. [↩]
- Pour les « “papes” ayant produit Vatican II », la chose est plus simple, leur « affiliation à des sectes acatholiques » les disqualifie par avance (p. 148). [↩]
- La question rhétorique (procédé fort prisé de l’A.), « comment prétendre que le Code ne reprend pas une constitution qu’il cite à de multiples reprises comme source de ses dispositions? » (p. 33) est, encore une fois, sophistique : certaines dispositions sont reprises, d’autres délaissées, voilà tout… Rappelons tout de même que la bulle Cum ex apostolatus occupe six pages du Bullaire ; cf. Francesco Gaude, Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum, t. 6, Turin, Dalmazzo, 1860, p. 551-556. [↩]
- Franz X. Wernz, Ius Decretalium, t. II, pars 2a, § 615, Rome, 1906, p. 353. [↩]
- « [Le pape] n’est jugé par personne, à moins qu’il ne dévie de la foi. » Sur ces aspects, voir La déposition du pape hérétique, Lieux théologiques, modèles canoniques, enjeux constitutionnels, Sous la direction de C. Dounot, N. Warembourg, B. Bernabé, Paris, Mare & Martin, 2019. [↩]
- L’A. a beau écrire : « Il n’a pas énoncé une simple disposition positive qu’un autre pape pourrait changer » (p. 34), cette assertion nullement fondée contredit l’histoire du droit canonique… [↩]
- Émile Jombart, Memento de droit canon, à l’usage des clercs, religieux, religieuses et laïcs, Paris, Beauchesne, 1958, p. 37, parle « d’apostasie publique de la foi catholique » ; Georges Bareille, Code du droit canonique, Modifications introduites dans la précédente législation de l’Église, Montréjeau, Cardeilhac-Soubiron / Arras, Brunet, 1929, p. 50, vise le clerc qui « apostasie publiquement » ; le Traité de droit canonique, t. 1, Publié sous la dir. de R. Naz, Paris, Letouzey et Ané, 21954, § 470, p. 343, traduit l’expression par « apostasie de la foi catholique ». Pour J. Bouché, art. « Apostasie », Dictionnaire de droit canonique, t. 1, Publié sous la dir. de R. Naz, Paris, Letouzey et Ané, 1935, col. 640-652 [col. 643], « l’idée d’abandon ou de défection est bien celle qui traduit le mieux le mouvement essentiel ou constitutif de l’apostasie. » L’abbé P. Pellé, Le Droit pénal de l’Église, Paris, Lethielleux, 1939, p. 223, écrit que « le mot grec apostasia signifie, en effet, défection. » Le can. 1325, § 2 reste dans ce champ lexical en appelant apostat celui qui « a fide christiana totaliter recedit ». Par comparaison, le can. 2339 prive de sépulture les « apostats a fide, les hérétiques ou les schismatiques », distinguant bien le rejet total de la foi de son rejet partiel. [↩]
- P. Pellé, Le Droit pénal de l’Église…, p. 46-47. [↩]
- Fr.-X. Wernz, Ius Decretalium, t. II, pars 2a, § 539…, p. 278. [↩]
- Cf. Traité de droit canonique, t. 4, Publié sous la dir. de R. Naz, Paris, Letouzey et Ané, 21955, § 1147, p. 706 ; P. Pellé, Le Droit pénal de l’Église…, p. 231-234. [↩]
- Cf. Bernard Tissier de Mallerais, Marcel Lefebvre, [Une vie], Étampes, Clovis, 2002, p. 332-334. [↩]
- S’il reconnaît, nominalement, que le pape puisse être docteur privé, il ne cède aucun espace concret à cette possibilité où le pape agirait comme tel, « c’est-à-dire en dehors de ses fonctions » (p. 46). [↩]
- Cf. Stéphane Harent, art. « Infaillibilité pontificale », Dictionnaire apologétique de la foi catholique, t. III, Sous la dir. d’A. d’Alès, Paris, Beauchesne, 1921, col. 1431. [↩]
- L’A. se contredit d’ailleurs, p. 116, en affirmant que les encycliques peuvent contenir une définition infaillible, après avoir soutenu qu’elles sont infaillibles en tout point. [↩]
- Paul Nau, Une source doctrinale, les encycliques, Essai sur l’autorité de leur enseignement, Paris, Éditions du Cèdre, 1952, p. 63. les problèmes de méthode du sédévacantisme [↩]
- Sur les aspects théologiques, voir Michel Labourdette, o.p., La Foi, « Grand cours » de théologie morale, t. 8, Paris, Parole et Silence, 2015, p. 114-140. Sur les aspects historiques, voir Bruno Neveu, « Les péripéties de la foi ecclésiastique », Sedes Sapientiae 78 (2001), p. 3-35. [↩]
- Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien, 24 mai 1990, § 24 ; voir aussi les § 28 et 33. [↩]
- Cf. Augustin-Marie Aubry, Obéir ou assentir? De la « soumission religieuse » au magistère simplement authentique, « Sed contra », Paris, Desclée de Brouwer, 2015, p. 332 s. Sur la question de l’autorité du magistère seulement authentique, voir Bernard Lucien, Les Degrés d’autorité du Magistère, La question de l’infaillibilité, doctrine catholique, développements récents, débats actuels, Feucherolles, La Nef, 2007, p. 42 s. [↩]
- Doit-on considérer que les prescriptions de Latran III et Latran IV sur la couleur des habits des ecclésiastiques, sur les délais en matière d’appel ou sur la périodicité des synodes provinciaux comme infaillibles ? [↩]
- Il renvoie ici au cardinal Billot, Tractatus De Ecclesia Christi (I, q. 14, thesis 31, § 1, 2), qui dit pourtant explicitement que la formule d’approbation n’est qu’un des critères propres aux locutions ex cathedra (p. 95). Le texte en question (§ 988), non reproduit, milite contre l’usage extensif de l’infaillibilité ; cf. Louis Billot, L’Église, t. 2. Sa constitution intime, trad. J.-M. Gleize, Courrier de Rome, s.l.n.d., p. 483. [↩]
- Sans entrer au cœur du problème, on soulignera que l’A. refuse de prendre en compte l’explication donnée par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1987, en réponse aux dubia de Mgr Lefebvre (p. 127). Sur cette question, voir en dernier lieu Antoine-M. de Araujo, « En définissant la liberté religieuse, Vatican II a-t-il contredit le magistère antérieur ? Une solution proposée par l’abbé Lucien », Sedes sapientiae, no 147 (2019), p. 47-78. [↩]





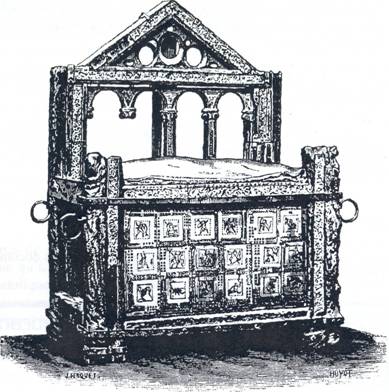
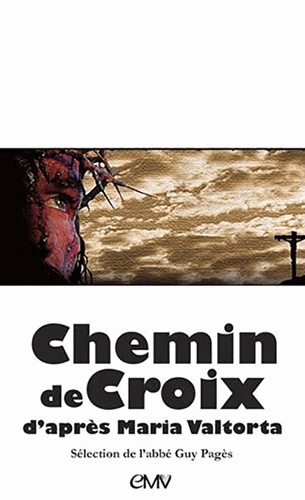









Derniers commentaires